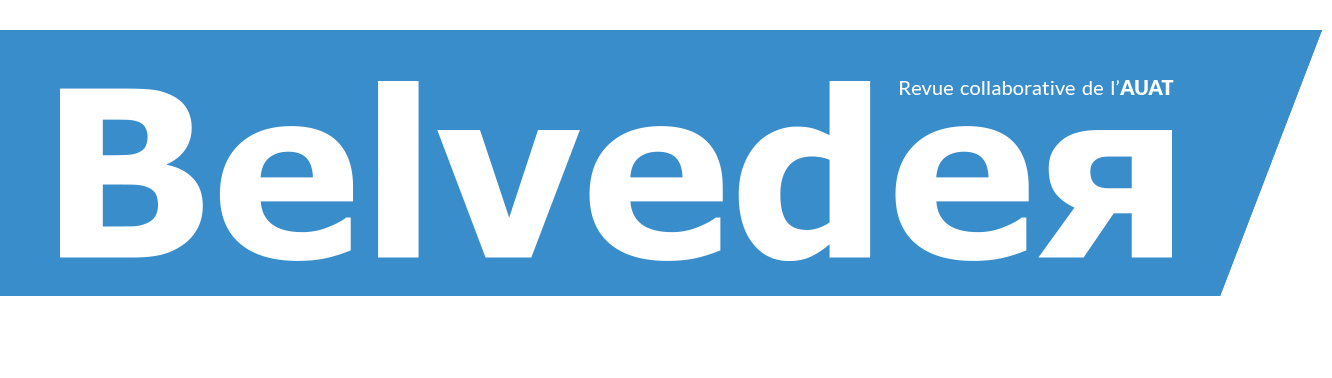Téléchargez l’article au format PDF
Jean-Paul LABORIE
Professeur émérite, membre du LISST - CIEU Université Toulouse II - Jean Jaurès
Jean-Paul Laborie revient pour nous sur les enjeux historiques liés à la délimitation de la frontière et à l’application de la loi Montagne dans les Pyrénées. Passé par la DATAR et au Commissariat du massif des Pyrénées, il est, depuis 20 ans, délégué permanent à l’aménagement de l’abornement et à l’entretien de la frontière franco-espagnole-andorrane.
Pouvez-vous nous résumer l’histoire de la frontière franco-espagnole-andorrane ?
Le tracé de la frontière est issu du traité des Pyrénées, du 7 novembre 1659, signé sur l’île des Faisans, au milieu du fleuve Bidassoa, dans les Pyrénées- Atlantiques. Il s’inspire en grande partie de la ligne de partage des eaux, c’est-à-dire que de chaque côté de cette ligne, les eaux de pluie s’écoulent soit vers le versant espagnol, soit vers le français. Il y a des exceptions, comme le Val d’Aran, où c’est l’écoulement des eaux de la Garonne qui délimite la frontière. Il peut aussi arriver qu’il y ait des plateaux parfaitement plats aux plus hautes altitudes. Faute de pouvoir appliquer le principe de ligne de partage des eaux, on trace alors la frontière au milieu du plateau. Pour en revenir au traité des Pyrénées, il est important de se souvenir que celui-ci a été une opération de sauvetage pour l’Espagne, à l’issue de la guerre de Trente Ans. Le royaume espagnol de Philippe IV était alors ruiné, tandis que celui de France, avec à sa tête Louis XIV, était en pleine expansion. Pour négocier, les Espagnols ont proposé le mariage de l’infante Marie-Thérèse d’Autriche, fille du roi d’Espagne, avec Louis XIV ; mariage qui a eu lieu un an après la signature du traité. Louis XIV n’était pas enthousiasmé par cette union qui relève plus du mariage forcé. Un parallèle peut être fait avec la délimitation de la frontière franco-espagnole puisqu’en guise de dot, l’Espagne a cédé à la France le Roussillon et la Cerdagne, soit ce qu’on appelle aujourd’hui la Catalogne française.
La délimitation de la frontière est-elle encore un sujet politique ?
Oui, comme partout, et ces enjeux politiques découlent d’enjeux financiers, environnementaux… C’est pour cela que j’utilise des données GPS pour repérer le tracé de la frontière, ça laisse moins de place au débat. Le répertoire des bornes GPS de la frontière a par exemple été publié en France, mais pas en Espagne. Certains territoires autonomes ne reconnaissent pas les coordonnées GPS utilisées, et la publication de la géolocalisation des bornes n’a donc pas eu lieu de ce côté-là de la frontière. Ma grande fierté, c’est d’avoir délimité la frontière avec l’Andorre en utilisant les projections GPS par satellite. Il y a, malgré tout, toujours des personnes qui refusent que la frontière passe dans leur jardin ou ne le savent pas. Je suis parfois très étonné. Par exemple, sur la route vers le Pas de la Case, un habitant avait ouvert une partie de son terrain pour que les personnes puissent y faire une halte pour pique-niquer. Malheureusement, en faisant cela, il ne s’est pas rendu compte qu’il venait de créer un passage transfrontalier ! J’essaye de mettre de l’ordre dans tout ça. Au-delà de ces anecdotes, les enjeux politiques relèvent aujourd’hui de questions de sécurité, car beaucoup de personnes et de marchandises transitent par les Pyrénées. Le besoin d’une infrastructure plus performante se fait de plus en plus ressentir, notamment en périodes d’enneigement. En plus d’une question de sécurité et de fluidité du trafic routier, il s’agit aussi de contrôler le trafic de drogues, pour lequel les Pyrénées sont un point de passage important.
Dans les années 1970, la DATAR a participé à l’impulsion d’une politique de la montagne à part entière. Elle a ainsi été la cheville ouvrière de la loi Montagne de 1985. Comment cette loi a-t-elle aidé au développement des Pyrénées ?
La loi Montagne s’applique aux zones de montagne de 48 départements, celles-ci comprenant les communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d’utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus aux conditions climatiques des zones d’altitude et/ou à la présence de fortes pentes[1]. Ces zones de montagne ont été délimitées par arrêté interministériel. Elles sont doublées de zones de massif, qui associent aux zones de montagne des espaces agricoles et des espaces remarquables à préserver qui leur sont directement contigus. Les zones de massif permettent donc de prendre en compte les spécificités locales, les qualités des espaces, leurs enjeux spécifiques. C’est à cette deuxième échelle que des comités de massif coordonnent le développement, l’aménagement et la protection des massifs. On en compte 6 aujourd’hui : Alpes, Corse, Massif central, Jura, Pyrénées, Vosges. Avec cette loi, on a amené l’aménagement du territoire à la montagne et on a donc promu une vision de projet pour ces territoires. C’est bien une loi d’urbanisme. Pour le bien ? Avec la réglementation de l’urbanisation des hameaux et des stations, la loi Montagne a mis les élus et les habitants face à des contraintes qui étaient jusqu’alors refusées. Pour le pire ? Avec l’accompagnement du développement massif du tourisme. La loi Montagne a aussi obligé à considérer les massifs dans leur entièreté, en proposant une vision à l’échelle de l’ensemble des Pyrénées, et de la même manière pour les Alpes, les Vosges, le Jura, la Corse et le Massif central…,cela en essayant d’homogénéiser des fonctionnements jusqu’alors distincts à l’intérieur même de ces massifs. Il faut reconnaître qu’il a été plus difficile de porter un projet de massif à l’échelle de l’ensemble des Pyrénées que dans les Alpes, par exemple. Il en résulte, encore aujourd’hui, une faible cohésion identitaire dans les Pyrénées. Différentes identités sont juxtaposées les unes à côté des autres, sans vision stratégique globale. Le massif des Pyrénées n’a pas non plus pleinement profité du développement de grandes métropoles comme Toulouse. Il en est toujours un espace périphérique. Il en a profité, mais seulement avec des dynamiques et des flux temporaires, et donc avec des territoires qui continuent de se vider.
Entretien réalisé par Théo Besanger, chargé de projets Planification à l’AUAT et Morgane Perset, rédactrice en cheffe de BelvedeR, chargée de mission Partenariats à l’AUAT.
[1] Article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
CC Sotos